Pourquoi l'Amérique comprend mal le monde, de Paul R. Pillar
Note de lecture
A l'approche de la présidentielle US, il n'est sans doute pas inutile de méditer sur l'exceptionnelle continuité de la politique étrangère américaine, que ce soit entre George W. Bush et Barack Obama ou entre William (Bill) Clinton et Ronald Reagan. Certes, la première marque de la politique étrangère d'une grande puissance est toujours ses invariables, quels que soient les hommes et les circonstances. Cela étant dit, l'Amérique est un cas à part. Elle se caractérise à la fois par une vision déformée de son rapport avec le « reste du monde » et par une incapacité flagrante à corriger cette déformation initiale, qui découlent, toutes les deux, directement de sa géographie et de son histoire.
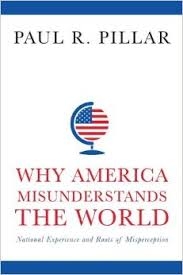
C'est cet enchaînement inéluctable qu'expose Paul R. Pillar dans son dernier ouvrage « Pourquoi l'Amérique comprend mal le monde : l'expérience nationale et les racines d'une perception erronée ».[1] Vétéran de la guerre du Vietnam, l'auteur a travaillé pendant 28 ans, de 1977 à 2005, à la CIA comme analyste de haut rang, y compris au poste de directeur adjoint du Centre de Contre-terrorisme de l'Agence. Il a également été chercheur à la Brookings Institution et professeur à l'Université de Georgetown, ayant signé deux livres « Le terrorisme et la politique étrangère américaine » en 1999 et « Le renseignement et la politique étrangère américaine » en 2011. Assurément, Paul R. Pillar pourrait difficilement être soupçonné « d'anti-américanisme primaire » ou de sympathies « anti-système ». Dès la préface, il tient à mettre les choses au clair : « Je suis content et fier d'être américain ».
Il n'empêche, son livre donne, sans doute malgré lui, une image beaucoup plus sombre de l'Amérique que les critiques habituelles sur la politique étrangère des Etats-Unis. La longue liste des failles (les « twists » ou erreurs de perception) y est présentée comme étant inscrite dans l'ADN même de la nation américaine. Il y a d'abord la géographie : la séparation physique de la nation-continent du « reste du monde », le fait de se savoir à l'abri derrière d'immenses remparts océaniques, sans avoir eu à craindre, pour une grande partie de son histoire, aucun danger existentiel, et sans jamais avoir eu sur son sol un adversaire digne de ce nom, ont été déterminants pour façonner la vision américaine du monde. A ceci, l'auteur oppose d'emblée l'expérience européenne, avec son espace bondé, ses multiples aspirations ethniques et nationales rivales, ses alliances et ses frontières souvent changeables.
Pour Paul R. Pillar, il n'y a pas de doute : la séparation géographique des Etats-Unis, avec son corollaire qu'est l'absence de réelles menaces, est à l'origine de leur difficulté persistante à appréhender la complexité des relations internationales. Les Américains se montrent ainsi remarquablement insensibles à la notion de « dilemme de sécurité » qui se trouve pourtant à la base de toute réflexion sur les rapports de force entre Etats. Il s'agit du concept selon lequel les mesures que prend un pays pour se protéger contre ce qu'il perçoit comme une menace, peuvent apparaître comme menaçantes aux yeux d'un autre Etat, lequel prend à son tour des mesures supplémentaires pour se prémunir contre cette menace-là. Il s'agit donc d'une spirale de perceptions et d'actions qui risquent de culminer dans une escalade. Ce n'est certainement pas le fruit du hasard si le scénario ressemble étrangement à ce qui se passe en Europe en ce moment, à l'instigation de l'Amérique/l'OTAN, sur les frontières orientales.
L'autre conséquence de l'isolement physique est la vision binaire qui établit une distinction nette entre d'un côté « le reste du monde », et de l'autre l'Amérique. Il est à noter que l'exceptionnalisme US, à savoir la conviction que les Etats-Unis sont intrinsèquement et qualitativement différents, autrement dit meilleurs que les autres nations, a pu se développer à l'abri des remises en causes permanentes que provoquaient, pour d'autres pays, les confrontations fréquentes avec des compétiteurs. De plus, cet exceptionnalisme est encore aggravé par deux facteurs. Le premier d'entre eux est le penchant pour concevoir la politique étrangère sous un prisme religieux et/ou moralisateur. Or s'il s'agit de s'opposer au Mal et de faire triompher le Bien, il n'y a pas de place pour analyser les motivations de l'Autre ni pour tenter de concilier les intérêts. Une approche à l'exact opposé de la Realpolitik traditionnelle des nations européennes.
Le sentiment de puissance et de prospérité, qui découle de l'abondance quasi illimitée des ressources à l'origine, rajoute une autre couche à l'exceptionnalisme des Etats-Unis. En effet, c'est une asymétrie fondamentale qui caractérise les relations de l'Amérique avec le reste du monde : les USA peuvent atteindre et influencer les Autres beaucoup plus que les Autres ne peuvent avoir d'impact sur eux. Ce déséquilibre leur garantit une position de force, mais une position de force qui se révèle être en même temps un verrou. Car Paul R. Pillar ne se contente pas de démontrer à quel point les errements de la politique étrangère américaine sont déterminés par des données immuables. Il va plus loin. Il suggère que, de par sa nature même, l'Amérique ne sera jamais vraiment capable d'y changer quoi que ce soit.
D'après l'auteur : « la force et le succès des Etats-Unis ont fait que, en dépit de leurs échecs périodiques en politique étrangère, les Américains sont peu enclins à l'introspection » afin de tirer les leçons et corriger leurs défaillances de perception et de compréhension du monde. D'autant plus que les responsables politiques, auxquels reviendraient normalement la tâche de rectifier les erreurs de perception des citoyens, préfèrent les exploiter à leurs propres fins plutôt que d'émettre des doutes sur ce qui constitue une vision partagée par l'écrasante majorité de l'opinion américaine. Paul R. Pillar en conclut que la manière de penser et de faire de la politique étrangère aux USA « va probablement perdurer – une conclusion décourageante dans la mesure où cette approche entraîne une incompréhension considérable et parfois dommageable par rapport à ce qui se passe à l'extérieur des Etats-Unis ».
L'auteur voit dans la politique étrangère américaine l'exemple-type de la tyrannie de l'opinion majoritaire, observée par Alexis de Tocqueville dès la première moitié du 19ème siècle : « Je ne connais pas de pays où il règne en général moins d'indépendance d'esprit et de véritable liberté de discussion qu'en Amérique », écrivait-il. Paul R. Pillar souligne à cet égard que les libertés sur le papier importent peu si ce qui est politiquement faisable n'y correspond pas. Or à partir du moment où un homme, ou une femme, politique américain décide de se porter candidat à un poste de responsabilité nationale, il lui sera impensable de remettre en question les perceptions dominantes érigées en postulats. « Se poser ouvertement des questions sur le fait que le terrorisme peut et doit être éradiqué, ou que les Etats-Unis sont suffisamment puissants pour accomplir pratiquement tout ce qu'ils veulent accomplir à l'étranger s'ils y mettent assez de ressources et de détermination, équivaudrait à un suicide politique ».
C'est à la lumière de l'analyse développée par Paul R. Pillar qu'il convient d'apprécier la récente passe d'armes entre les candidats Clinton et Trump au sujet, précisément, de l'exceptionnalisme des Etats-Unis. En position de challenger, le candidat républicain avait choisi pour devise la promesse de « rendre sa grandeur à l'Amérique ».[2] Le Président Obama n'a pas manqué de rétorquer que « L'Amérique est déjà grande, l'Amérique est déjà forte ».[3] Mais c'est à la candidate démocrate qu'est revenu l'honneur d'exposer cet argumentaire en bonne et due forme. Le discours qu'elle a prononcé devant les vétérans est l'illustration parfaite des travers détaillés dans l'ouvrage de Paul R. Pillar.
« S'il y a une croyance fondamentale qui m'a guidée et m'a inspirée à chaque étape de mon chemin, c'est que les États-Unis sont une nation exceptionnelle. Je crois que nous sommes encore le meilleur espoir de la terre, comme disait Lincoln ; la cité qui brille sur la colline, pour citer Reagan ; le grand pays formidable, généreux et compatissant, pour reprendre les termes de Robert Kennedy. Et ce n'est pas seulement le fait que nous avons l'armée la plus puissante au monde ou que notre économie est plus importante qu'aucune autre sur la Terre. C'est aussi la force de nos valeurs, la force du peuple américain. (…) En effet, nous sommes la nation indispensable du monde. Les peuples du monde nous regardent et nous suivent. (…) L'Amérique a une capacité unique et inégalée d'être une force pour la paix et pour le progrès, un champion de la liberté et de l'opportunité. Notre puissance porte en elle la responsabilité de diriger. Car si l'Amérique ne dirige plus, nous laissons un vide qui provoque le chaos, ou que d'autres Etats et réseaux s'y précipitent pour combler ce vide. Peu importe donc si c'est difficile, peu importe l'ampleur du défi, l'Amérique doit diriger. »[4]
[1] Paul R. Pillar, "Why America Misunderstands the World – National Experience and the Roots of Misperception", Columbia University Press, 2016.
[2] “Make America Great Again”, ce qui est en fait une reprise du slogan de campagne du candidat Ronald Reagan en 1980, “Let's Make America Great Again”.
[3] Transcript: President Obama's Democratic National Convention speech, Los Angeles Times 27 juillet 2016.
[4] Read Hillary Clinton's Speech Touting ‘American Exceptionalism', Time, 31 août 2016.
etats-unis
